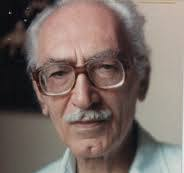هنري آلبان فورنييه المعروف باسم آلان فورنييه كاتب فرنسي، ولد في بلدة لاشابيل دنجيّون في مقاطعة لوشير في فرنسة. وتوفي في الحرب العالمية الأولى (22 أيلول) مفقوداً في معركة «موز» .
أمضى آلان فورنييه طفولته في الريف الفرنسي حيث عمل والداه مدرسين في المدرسة الابتدائية في مسقط رأسه، وتبدو ذكرياته عن تلك الحقبة واضحة في كتاباته الروائية والشعرية. وفي عام 1903، وبعد تجربة الدراسة في معهد فولتير في باريس مدة سنة وفي المدرسة البحرية في بريست Brest سنة أخرى، التقى في معهد لاكانال في باريس جاك ريفيير Jacques Rivière (الفيلسوف الذي أصبح فيما بعد زوجاً لشقيقته إيزابيل)، ونشأت بينهما صداقة حميمة استمرت حتى وفاة الكاتب، وعبرت عنها المراسلات بينهما على امتداد تسع سنوات (من عام 1905 إلى عام 1914). وقد عمد جاك ريفيير إلى نشر هذه الرسائل مع غيرها من رسائل آلان فورنييه إلى أهله وذويه بعد وفاة هذا الأخير لأهميتها، إذ كانت تعكس الجو الثقافي والفني في فرنسة في بداية هذا القرن، وتبيّن موقف آلان فورنييه من التيارات والمدارس الأدبية السائدة حينذاك، كالمدرسة الرمزية، وموقفه من بعض كتاب تلك الحقبة مثل رامبو [ر] Rimbaud وأندريه جيد[ر] André Gide وبول كلوديل[ر] Paul Claudel وغيرهم.
وفي عام 1907 بعد أن أخفق آلان فورنييه أكثر من مرة في امتحان التخرج في دار المعلمين العليا L'école normale supérieure تخلى نهائياً عن فكرة متابعة دراسته، وأدى خدمة العلم مدة عامين لم ينقطع إبانهما عن اهتماماته الأدبية والفنية. ثم تفرغ بعدها للكتابة الصحفية والأدبية، وكتب مجموعة من المقالات والقصص القصيرة والدراسات التي نشرت تباعاً في الصحف والمجلات بدءاً من عام 1910، وهو العام الذي بدأ فيه بمراسلة الكاتب شارل بيغي [ر] Charles Péguy الذي ربطته به صداقة خاصة حتى وفاته.
وروايته «مولن الكبير» Le Grand Meaulnes هي النتاج الوحيد الذي نشر في أثناء حياة الكاتب، وذلك في عام 1913، واقترن اسم فورنييه، منذ ذلك الحين، بهذه الرواية التي اشتهرت كثيراً (وأنتجت سينمائياً عام 1967) لفرادتها، ولما كان لها من تأثير في الكتابة الروائية عامّة في بداية القرن العشرين. والرواية بموضوعها ترتبط ارتباطاً مباشراً بحياة الكاتب واهتماماته في مدى السنوات الثماني التي استغرقتها الكتابة، وذلك عن طريق موضوع رئيسٍ يظهر أيضاً في كتاباته الشعرية، وهو موضوع الصداقة والحب والمغامرة. فالرواية تصوّر ذكريات الطفولة الهنيئة للكاتب في الريف وذكريات الانتقال الصعب إلى المدينة، إذ ترد تلك الذكريات في الرواية بأسلوب سرد روائي شاعري لمغامرات شخصياتها، ويعكس في جوهره اهتمامات الكاتب الشخصية في مراحل الطفولة والبلوغ والمراهقة، إضافةً إلى الانتقال من مرحلة إلى أخرى وما يمكن أن يحمله هذا الانتقال من شعور بالحنين أو بالخطيئة. وكان حب المغامرة في هذه الرواية الدافع إلى الحبكة الروائية: لقاء عابر أشبه بالحلم بين الشاب مولن وفتاة أحلامه في مكان شبه خيالي، تليه محاولة يائسة لتحويل الحلم إلى حقيقة عن طريق البحث المستمر والمتكرر عنها، إلا أن السعادة تبدو أمامه شيئاً مستحيلاً.
بعد وفاة آلان فورنييه، جمعت أعماله ونشرت في كتاب صدر عام 1924 تحت اسم «معجزات» Miracles، ويحتوي هذا الكتاب سبع قصائد كتبت بين عامي 1905 و1906، ودارت حول موضوعات الطفولة والريف والحب، فضلاً عن دراسات وقصص قصيرة، ظهرت في الصحف ما بين عامي 1907 - 1910 وفصل محذوف من روايته «مولن الكبير».
Trois poèmes par Alain-Fournier.
ET MAINTENANT QUE C’EST LA PLUIE…
Et maintenant que c’est la pluie et le grand vent
de Janvier
et que les vitres de la serre
où je me suis réfugié
font, sous la pluie, leur petit bruit de verre
toute la journée.
et que le vent, qui rabat la fumée des cheminées,
dégrafe et soulève
les vignes vierges de la tonnelle,
Je ne sais plus où Elle est…Où est-elle?
A pas pleins d’eau, par les allées,
dans le sable mouillé
du jardin
qui nous fut à tous deux notre rêve de Juin,
Elle s’en allée…
et la maison
où nous avions, tout cet été,
sous les feuilles des avenues qu’on arrosait,
imaginé
de passer notre vie comme une belle saison,
la maison,
dans mon coeur, abandonnée, est froide
avec son toit
d’ardoise luisant d’eau,
et ses nids de moineaux
dénichés et pourris qui penchant aux corniches
et traînent dans le vent…
Il va bientôt faire nuit,
et le grand vent bruineux tourne les parapluies
et mouille au visage
les dames qui reviennent du village
et ouvrent la grille…
Mon amie
O Demoiselle
qui n’êtes pas ici,
cette heure-ci
passe, et la grille ne grince pas,
je n vous attend pas,
je ne soulève
pas le rideau
pour vous voir, dans le vent et l’eau,
venir.
Cette heure passe, mon amie;
Ce n’est pas une heure de notre vie…
et nous l’aurions aimée, pourtant, comme toutes
celles
de toute la vie
apportée simplement dans vos mains graves de
dame belle.
Vous êtes partie…
Il bruine
dans les allées
qui ont mouillé
vos chevilles fines.
Il bruine dans les marronniers
confus et sombres
et sur les bancs où, cet été, à l’ombre,
avec l’été
vous vous series assise, blonde!
Il bruine sur la maison et sur la grille et dans les ifs
de l’entrée
que, pour la dernière fois
peut-être je regarde, en songeant à mi-voix
peut-être pour la dernière fois :
“Elle est très loin…où est-elle…son front pensif
appuyé à quelle croisée?”
A la tombée de la nuit,
je vais fermer, aux fenêtres d’ici,
les volets qui battent et se mouillent,
et j’irai sur la pelouse
rentrer
un jeu de croquet oublié qui se mouille.
*****
CHANT DE ROUTE
<<….des grandes routes où nul ne passe.>>
—JULES LAFORGUE
Un conquérant, puis tous, chantent :
Nous avons eu la fièvre
de tes marais.
Nous avons eu la fièvre et nous sommes partis.
Nous étions avertis
qu’on ne trouvait
que de soleil
au plus profond de tes forêts.
Nous avons eu des histoires
de brancards
cassés,
de fers perdus,
de cheveaux blessés,
d’ânes fourbus
et suants qui refusaient d’avancer.
Nous avons perdu la mémoire de ces histoires
que l’on raconte à l’arrivée ;
nous n’avions pas l’espoir
d’arriver.
Nous avons pris les harnais
pour nous en faire
des souliers.
Nous sommes repartis, à pied dans tes genêts
qui font saigner les pieds
et nos pieds ont saigné,
et nos pieds ont séché
dans ta poussière,
en marchant,
et nous avons guéri leurs plaies
en écrasant,
en marchant,
le baume et le parfums sauvages de tes bruyères.
Nous aurions pu asseoir
au revers des fossés
nos corps fumants et harassés.
Nous n’avions rien à dire : nous n’avions pas
d’espoirs.
Nous n’avions rien à dire; nous n’avions rien à boire.
Nous avons préféré la déroute
sans fin
des horizons et des routes,
des horizons défaits qui se refont plus loin
et des kilomètres qu’on laisse en arrière
dans la poussière
pour attraper ceux qu’on voit plus loin,
avec leur bornes
indicatrices de villes aux noms lointains
aux noms qui sonnent
comme les cailloux de tes chemins
sous nos talons.
Nous n’atteindrons jamais les villes de merveilles
qui ne sont que des noms
qui sonnent,
les noms des villes qui sont mortes au soleil.
Mais nous, nous voulons vivre au Soleil,
de tes cieux
avec nos crânes en feu,
et faire sonner sans fin les étapes de gloire
avec nos pieds d’étincelles.
Nous avons pour chanter des gosiers de victoire
et nous avons nos chants pour nous verser à boire
et nous avons la fièvre
de tes marais séchés au grand soleil
de tes routes de poussière
de tes villes de mirage.
Nous avons eu la fièvre
de tes forêts sans ombre – et tes bruyères des sables
avec leurs regards roux et leur parfums sauvages
nous ont donné la fièvre.
***
CONTE DU SOLEIL ET DE LA ROUTE
(A une petite fille)
− Un peu plus d’ombre sous les marronniers
des places,
Un peu plus de soleil sur la grande route lasse…
Des noces passeront, aux << beaux jours >> étouffants,
sur la grand’route, au grand soleil, et sur deux rangs.
De très long cortèges de noces campagnardes
avec de beaux habits dont tout le monde parle
Et de petits enfants, dans la noce, effarés,
auront de très petits << gros chagrins >> ignorés…
− Je songe à l’Un, petit garçon, qui me ressemble
et, les matins légers de printemps, sous les trembles,
à cause du ciel tiède et des haies d’églantiers,
parce qu’il était seul, qu’on l’avait invité,
se prenait à rêver à la noce d’Eté :
<<… On me mettra peut-être−on−l’a dit−avec Elle
qui me fait pleurer dans mon lit, et qui est belle…
(Si vous saviez−les soirs, quelquefois−ô mamans,
les pleurs de tristesse et d’amour de vos enfants!)
<<… J’aurai mon grand chapeau de paille neuve et
blanche ;
sur mon bras la dentelle envolée de sa manche…>>
− Et je rêve son rêve aux habits de Dimanche.
“… Oh! le beau temps d’amour et d’Eté qu’il fera,
Et qu’elle sera douce et penchée, à mon bras.
J’irai à petits pas. Je tiendrai son ombrelle.
Très doucement, je lui dirai “Mademoiselle”
d’abord−Et puis, le soir, peut-être, j’oserai,
si l’étape est très longue, et si le soir est frais,
serrer si fort son bras, et lui dire si près,
à perdre haleine, et sans chercher, des mots si vrais
qu’elle en aura << ses >> yeux mouillés – des mots
si tendres
qu’elle me répondra, sans que personne entende …”
− Et je songe, à present, aux mariées pas jolies
qu’on voit, les matins chauds, descendre des mairies
Sur la route aveuglante, en musique, et traîner
des couples en cortège, aux habits étrennés.
Et je songe, dans la poussière de leurs traînes
où passent, deux à deux, les fillettes hautaines
les fillettes en blanc, aux manches de dentelles,
Et les garcons venus des grandes Villes – laids,
avec de laids bouquets de fleurs artifiicielles,
– je songe aux petits gars oubliés, affolés
qu’on n’a mis, << au dernier moment >>, avec personne
− aux petits gars des bourgs, amoureux bousculés
par le cortège au pas ridicule et rythmé
− aux petits gars qui ne s’en vont avec personne
dans le cortège qui s’en va, fier et traîné
vers l’allégresse sans raison, là-bas, qui sonne.
− Et tout petits, tout éperdus, le long des rangs,
ne peuvent même plus retrouver leurs mamans.
− Un surtout…qui me ressemble de plus en plus !
un surtout, que je vois – un surtout… a perdu
au grand vent poussiéreux, au grand soleil de joie,
son beau chapeau tout neuf, blanc de paille et de soie,
et je le vois … sur la route …qui court après
− et perd le défilé des << Messieurs>> et des <>−
court après–et fait rire de lui–court après,
aveuglé de soleil, de poussière et de larmes …
♦
*******
Le Grand Meaulnes - Extrait
L'Évasion.
A une heure de l'après-midi, le lendemain, la classe du Cours supérieur est claire, au milieu du paysage gelé, comme une barque sur l'Océan. On n'y sent pas la saumure ni le cambouis, comme sur un bateau de pêche, mais les harengs grillés sur le poêle et la laine roussie de ceux qui, en rentrant, se sont chauffés de trop près.
On a distribué, car la fin de l'année approche, les cahiers de compositions. Et, pendant que M. Seurel écrit au tableau l'énoncé des problèmes, un silence imparfait s'établit, mêlé de conversations à voix basse, coupé de petits cris étouffés et de phrases dont on ne dit que les premiers mots pour effrayer son voisin :
"Monsieur ! Un tel me..."
M. Seurel, en copiant ses problèmes, pense à autre chose. Il se retourne de temps à autre, en regardant tout le monde d'un air à la fois sévère et absent. Et ce remue-ménage sournois cesse complètement, une seconde, pour reprendre ensuite, tout doucement d'abord, comme un ronronnement.
Seul, au milieu de cette agitation, je me tais. Assis au bout d'une des tables de la division des plus jeunes, près des grandes vitres, je n'ai qu'à me redresser un peu pour apercevoir le jardin, le ruisseau dans le bas, puis les champs.
De temps à autre, je me soulève sur la pointe des pieds et je regarde anxieusement du côté de la ferme de la Belle-Etoile. Dès le début de la classe, je me suis aperçu que Meaulnes n'était pas rentré après la récréation de midi. Son voisin de table a bien dû s'en apercevoir aussi. Il n'a rien dit encore, préoccupé par sa composition. Mais, dès qu'il aura levé la tête, la nouvelle courra par toute la classe, et quelqu'un, comme c'est l'usage, ne manquera par de crier à haute voix les premiers mots de la phrase :
"Monsieur ! Meaulnes..."
Je sais que Meaulnes est parti. Plus exactement, je le soupçonne de s'être échappé. Sitôt le déjeuner terminé, il a dû sauter le petit mur et filer à travers champs, en passant le ruisseau à la Vieille-Planche, jusqu'à la Belle-Etoile. Il aura demandé la jument pour aller chercher M. et Mme Charpentier. Il fait atteler en ce moment.
La Belle-Etoile est, là-bas, de l'autre côté du ruisseau, sur le versant de la côte, une grande ferme, que les ormes, les chênes de la cour et les haies vives cachent en été. Elle est placée sur un petit chemin qui rejoint d'un côté la route de La Gare, de l'autre un faubourg du pays. Entourée de hauts murs soutenus par des contreforts dont le pied baigne dans le fumier, la grande bâtisse féodale est au mois de juin enfouie sous les feuilles, et, de l'école, on entend seulement, à la tombée de la nuit, le roulement des charrois et les cris des vachers. Mais aujourd'hui, j'aperçois par la vitre, entre les arbres dépouillés, le haut mur grisâtre de la cour, la porte d'entrée, puis, entre des tronçons de haie, un bande du chemin blanchi de givre, parallèle au ruisseau, qui mène à la route de La Gare.
Rien ne bouge encore dans ce clair paysage d'hiver. Rien n'est changé encore.
Ici, M. Seurel achève de copier le deuxième problème. Il en donne trois d'habitude. Si aujourd'hui par hasard, il n'en donnait que deux... Il remonterait aussitôt dans sa chaire et s'apercevait de l'absence de Meaulnes. Il enverrait pour le chercher à travers le bourg deux gamins qui parviendraient certainement à le découvrir avant que la jument ne soit attelée...
M. Seurel, le deuxième problème copié, laisse un instant retomber son bras fatigué... Puis, à mon grand soulagement, il va à la ligne et recommence à écrire en disant :
"Ceci, maintenant, n'est plus qu'un jeu d'enfant !"
... Deux petits traits noirs, qui dépassaient le mur de la Belle-Etoile et qui devaient être les deux brancards dressés d'une voiture, ont disparu. Je suis sûr maintenant qu'on fait là-bas les préparatifs du départ de Meaulnes. Voici la jument qui passe la tête et le poitrail entre les deux pilastres de l'entrée, puis s'arrête, tandis qu'on fixe sans doute, à l'arrière de la voiture un second siège pour les voyageurs que Meaulnes prétend ramener. Enfin tout l'équipage sort lentement de la cour, disparaît un instant derrière la haie, et repasse avec la même lenteur sur le bout de chemin blanc qu'on aperçoit entre deux tronçons de la clôture. Je reconnais alors, dans cette forme noire qui tient les guides, un coude nonchalamment appuyé sur le côté de la voiture, à la façon paysanne, mon compagnon Augustin Meaulnes.
Un instant encore tout disparaît derrière la haie. Deux hommes qui sont restés au portail de la Belle-Etoile, à regarder partir la voiture, se concertent maintenant avec une animation croissante. L'un d'eux ce décide enfin à mettre sa main en porte-voix près de sa bouche et à appeler Meaulnes, puis à courir quelques pas, dans sa direction, sur le chemin... Mais alors, dans la voiture qui est lentement arrivée sur la route de La Gare et que du petit chemin on ne doit plus apercevoir, Meaulnes change soudain d'attitude. Un pied sur le devant, dressé comme un conducteur de char romain, secouant à deux mains les guides, il lance sa bête à fond de train et disparaît en un instant de l'autre côté de la montée. Sur le chemin, l'homme qui appelait s'est repris à courir ; l'autre s'est lancé au galop à travers champs et semble venir vers nous.
En quelques minutes, et au moment même où M. Seurel, quittant le tableau, se frotte les mains pour en enlever la craie, au moment où trois voix à la fois crient du fond de la classe :
"Monsieur ! Le grand Meaulnes est parti !"
L'homme en blouse bleue est à la porte, qu'il ouvre soudain toute grande, et, levant son chapeau, il demande sur le seuil :
"Excusez-moi, monsieur, c'est-il vous qui avez autorisé cet élève à demander la voiture pour aller à Vierzon chercher vos parents ? Il nous est venu des soupçons...
- Mais pas du tout !" répond M. Seurel.
Et aussitôt c'est dans la classe un désarroi effroyable. Les trois premiers, près de la sortie, ordinairement chargés de pourchasser à coups de pierres les chèvres ou les porcs qui viennent brouter dans la cour les corbeilles d'argent, se sont précipités à la porte. Au violent piétinement de leurs sabots ferrés sur les dalles de l'école a succédé, dehors, le bruit étouffé de leurs pas précipités qui mâchent le sable de la cour et dérapent au virage de la petite grille ouverte sur la route. Tout le reste de la classe s'entasse aux fenêtres du jardin. Certains ont grimpé sur les tables pour mieux voir...
Mais il est trop tard. Le grand Meaulnes s'est évadé.
"Tu iras tout de même à La Gare avec Moucheboeuf, me dit M. Seurel. Meaulnes ne connaît pas le chemin de Vierzon. Il se perdra aux carrefours. Il ne sera pas au train pour trois heures".
Sur le seuil de la petite classe, Millie tend le cou pour demander :
"Mais qu'y a-t-il donc ?"
Dans la rue du bourg, les gens commencent à s'attrouper. Le paysan est toujours là, immobile, entêté, son chapeau à la main, comme quelqu'un qui demande justice.